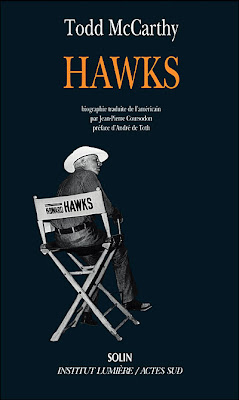1) L.O.L. n’est pas lol.
2) L.O.L. est terrifiant.
Inutile cependant d’accabler Liza Azuelos ; Liza Azuelos n’existe pas. Dans le monde de L.O.L. (car L.O.L. crée un monde), il n’y a que les jeunes et les vieux. Liza Azuelos, comme Aristote, définit des catégories. Elle nous apprend (car L.O.L. est didactique) à distinguer deux races. Et la chose est difficile : d’un pur point de vue anthropologique, les comportements des jeunes et des vieux observent dans le film une presque similarité. La différence tient essentiellement à leur motricité : le jeune ne se meut qu’à pied ou se fait conduire ; le vieux, au contraire, se déplace aussi bien en voiture qu’en moto ou en bateau ; le jeune, d’instinct encore grégaire, évolue avec un groupe dont il se sépare le moins possible ; le vieux, quant il sort de la tanière familiale dont il est le maître respecté, demeure dans une solitude contrariée. Le jeune parle aux jeunes mais peu, ou mal, aux vieux. Le vieux essaye de s’adresser au jeune mais n’y parvient pas. Le vieux a été jeune mais il ne l’est plus : Sophie Marceau a fait sa boum mais La Boum, c’était en 1980. Elle doit donc aujourd’hui changer de camp et (attention, idée !) jouer la mère à son tour.
Cela, pourtant, importe peu. Parce que ce qui est bien, avec Sophie Marceau, c’est qu’ado ou adulte, fille ou mère, elle est toujours Sophie Marceau. C'est-à-dire qu’elle évolue et grandit avec nous, comme nous : elle nous ressemble. « Madame Bovary, c’est moi » avouait Flaubert. Liza Azuelos lui répond : « Sophie Marceau, c’est nous ». Et ce nous là est important. L.O.L., film catégoriel, est aussi un film représentatif. Et représentatif parce que catégoriel. Parce quand on parle des jeunes, on parle d’aujourd’hui ; et quand on parle de nos enfants, on parle de nous. L.O.L., disons-le, est non seulement un film « incroyablement actuel » (c’est Marie Sauvion qui le dit, donc c’est vrai), mais un film qui nous parle de nous. Etant entendu, bien sûr, que nous habitons dans le seizième arrondissement, que notre maison est un hôtel particulier, et que nous n’avons d’autre souci (que nous ayons 16 ou 45 ans) que de savoir si, oui ou non, nous allons coucher avec lui (le mec). L.O.L., c’est sa force, est un film représentatif qui ne représente personne. Ou alors quelques uns mais, à la limite, le film ne leur est pas destiné. L.O.L., c’est un film pour les autres, tous ceux qui ne se reconnaissent a priori pas dans ce « nous », et d’abord les jeunes, à qui il s’adresse directement. Or L.O.L. ne dit pas « vous, les jeunes, vous êtes comme nous », mais « regardez nous, nous sommes les mêmes », ce qui est à la fois plus honnête et bien plus terrible. Il faut avoir vu la mère commenter l’épilation pubienne de la fille, les deux couples d’amis s’allumer un joint après le dîner ou, surtout, le père autoritaire (il est ministre) aller au concert de son fils (il est rockeur) et commencer à se dandiner pour savoir ce que c’est, vraiment, qu’un film d’horreur. Car soudain, le cauchemar se précise : un monde où les plus différents d’eux seraient eux, un monde où ils n’existeraient qu’eux, un monde où nous serions tous lol. Mdr ? Non, mort de peur.

M. P.