A première vue, l’espace hawksien est sans limites. La frontière, c’est le problème de Ford. Howard est l’homme de l’air et se moque bien du tracé des états. Il éprouve sa liberté quand il le veut. Tous ses films le montrent : un homme enfermé dans son milieu a toujours, à un moment ou un autre, l’occasion de prendre ses distances. La caricature de ce schéma aboutira bien entendu au prodigieux Monkey Business, où le savant régresse jusqu’à l’enfance, redevenant même nourrisson. Incapable de parler, il rejoindra son corps et son statut in extremis. Chérie, je me sens rajeunir : quoi de plus effrayant que cette liberté-là ?

C’est The Big Sky, le film précédent, que nous prendrons pour exemple de notre démonstration, pour la bonne et simple raison qu’il aborde le même schéma de front : avant de revenir à leur place, les aventuriers s’éloignent concrètement de leur Amérique, dans le temps et l’espace. Et, fait rare chez H.H., ils se confrontent à des langues inconnues, les écoutent et les craignent, alors que les héros de Hatari ! n’auront que faire de communiquer avec les indigènes. Avant d’éclater, le « génie de Howard Hawks » devait sans doute mesurer ici l’étendue de son pouvoir. Les hommes sont peut-être libres d’être qui ils veulent, mais pas de comprendre tout le monde : on parle au moins trois langues dans La Captive aux yeux clairs. L’anglais, bien sûr, celle des héros, mais aussi le français et une langue indienne, apparemment le Niitsipussin. La présence de bandes Pieds-Noirs près du Missouri semble historiquement attestée, tout comme l’importance de la population française dans la région vers 1830. Si la proximité des langues étonne, c’est plutôt par rapport à l’image habituelle, stéréotypée, du western classique. Sortit dans les salles en 1952, le film laisse pourtant peu de place aux topoy du genre : les deux personnages principaux y travaillent pour une compagnie de commerce, tombent tous deux amoureux d’une indienne, et l’intrigue qui les lie se déploie essentiellement autour d’un bateau. Tout comme ses personnages décident de remonter la rivière jusqu’aux territoires alors inexplorés par « l’homme blanc », Hawks s’attache ici à élargir l’univers du western: l’action commence en 1832, au Kentucky, et finira presque six mois plus tard au nord du Montana, bien loin de l’ouest de la fin du siècle. D’emblée, le cinéaste place son film sous le signe de l’inattendu et de la découverte. Inspiré du roman du même nom d’A. B. Guthrie Jr, le scénario de The Big Sky n’est d’ailleurs qu’une suite de rencontres : entre Jim et le jeune Boone, entre les deux protagonistes et l’oncle Zeb, puis entre l’équipage du bateau et la captive indienne, l’indien Poor Devil, la compagnie concurrente, les Crows et enfin les Pieds-Noirs. La moitié de ces confrontations mettent au moins deux langues différentes en présence, avec, chaque fois, un seul traducteur possible. Obstacle à toutes formes de communications, la langue est un problème d’importance pour ces marchands décidés à faire du troc avec la tribu la plus reculée de ce « pays immense et sauvage ». Le problème parait même insurmontable pour deux aventuriers amoureux comme ici d’une princesse indienne. Dans les rapports d’amitié et de rivalité qui structurent le film, la langue sera l’enjeu de tous les désirs.
La Captive aux yeux clairs se présente comme un récit de pionniers. Le générique passé, un texte défilant prévient : « Cette histoire est celle des premiers hommes qui explorèrent en bateau le cours du Haut-Missouri […] et ouvrirent ainsi le passage vers le grand Nord-Ouest ». Le film va parcourir trois mille kilomètres en 138 minutes – la version « longue » originale réintègre seize minutes particulièrement admirables, c’est sur elle que nous nous fonderons. Et, pour accentuer ce caractère épique, la voix off d’un narrateur parlant au passé, en anglais, intervient dès le début. Ce conteur pour l’instant inconnu reprend le plus souvent la parole après chaque séquence, relançant régulièrement l’action en même temps que la musique de Dimitri Tiomkin. Ce rythme, calqué sur celui du voyage, exclut pourtant le quotidien de l’expédition. Plus encore que le roman, le film élude tous les jours sans surprises. Dès le premier trajet pour Saint Louis, il confère au contraire à chaque scène un caractère mythologique. Le Jim Deakins qu’interprète Kirk Douglas apparaît comme l’homme qui brave la rivière et c’est en tuant le serpent qui le menaçait que Boone Caudill fait sa connaissance, c’est en dormant à la belle étoile, près d’un feu, que les deux hommes se présentent vraiment. Leur parcours semble d’une telle ampleur que les héros sont déjà dépaysés en arrivant à Saint Louis. Là, c’est la taille de cette « fourmilière » de plus de dix mille habitants qui les étonne et donne aux nouveaux venus l’air d’étrangers. Lorsqu’ils entrent dans le saloon où l’on chante et parle en français, les deux américains ne sont plus ni surpris ni gênés. A tel point qu’ils semblent d’abord comprendre le français : au « vous désirez ? » de la serveuse, Jim répond aussitôt, et en anglais. S’ils ne parlent pas vraiment la langue, les deux partis se comprennent assez bien pour que la traduction ne soit qu’une question de secondes. La familiarité est alors plus une question d’atmosphère que de langue. Ce n’est qu’avec Bourdonnais, le propriétaire du Mandan, le bateau sur lequel ils s’engageront, que le français deviendra indéchiffrable pour les deux héros. Il sera d’ailleurs plusieurs fois désigné comme « le Français ». Et, dès lors, le seul anglophone à le comprendre sera Zeb Calloway, l’oncle de Boone joué par Arthur Hunicutt. A chaque ordre, chaque annonce du capitaine faite dans sa langue d’origine, le vieux trappeur folklorique rapportera ainsi la traduction aux deux amis. Intégrés à l’équipage majoritairement français, ces derniers n’en sont séparés que par un léger retard de compréhension. A partir du moment où quelqu’un est là pour parler l’anglais, que tout le monde est capable de le comprendre et de le balbutier, même avec un fort accent, il ne semble pas y avoir de malentendu possible. Petit à petit, cette voix qui rassemble les hommes des deux langues, qui vient rappeler à Bourdonnais que l’une est plus universelle à bord – « Speak english ! » lui intime t-il quelquefois -, cette voix sereine et expérimentée apparaît comme celle du narrateur. Le spectateur la reconnaît et se fie avec confiance à ses traductions. Plus soucieux de lisibilité que de réalisme, Hawks, aidé de Dudley Nichols, choisit d’ailleurs de limiter les dialogues en français. Tout ce qui est utile à l’action est traduit par Zeb. Les rares phrases accessibles aux seuls francophones sont des exclamations rapides, qui échappent même par moments à leurs auteurs dans le feu de l’action ou du dialogue. « Sacré nom de nom… » prononce par exemple « le Français » avec un fort accent nord américain avant d’être rappelé à l’ordre, d’expliquer sa colère lorsque ses hommes découvrent la présence de la captive indienne. La scène le démontre parfaitement, la barrière de la langue n’est encore qu’une affaire de délai : il ne faut que quelques instants pour rétablir la compréhension et l’égalité entre tous.
Le problème posé par la langue indienne sera tout de suite d’une toute autre ampleur. Lorsque l’Indienne apparaît, personne ne lui parle. Car cette fois seul l’oncle Zeb, on l’apprendra plus tard, parle la langue de l’étranger, celle des Pieds-Noirs. Mais tel n’est pas le plus grand obstacle à la communication. Dès son apparition, au sens littéral du terme, la jeune femme fait en effet l’objet d’un tabou. Elle est celle qu’il ne fallait pas voir, celle qu’il ne faut pas toucher sous peine de mort, celle que l’on ne peut quasiment pas approcher sans être soupçonné d’arrière-pensées. L’interdiction est, là aussi, quasiment d’ordre mythologique. La seule femme à bord est une monnaie d’échange, l’otage qui permettra de traverser le territoire des Pieds-noirs sans danger et d’obtenir des peaux à des conditions avantageuses. Elle la fille d’un chef Pied-Noir, une princesse capturée par les Crows, peuple rival, et qui a pu s’échapper mais est tombée aux mains des Blancs « il y a trois ou quatre ans ». Vivant comme une prisonnière, la jeune fille refuse depuis de parler à quiconque. Au-delà même de la connaissance de la langue et de l’interdit posé à l’équipage, le dialogue est donc soumis à la volonté de la princesse indienne. Contrairement aux marins et aux chasseurs, elle n’occupe pas la même position que ses interlocuteurs. Entre le français, majoritaire à bord, et l’anglais, déjà majoritaire dans la région à l’époque, il ne saurait y avoir de différence autre que culturelle. Sûrs de venir du même pays, les uns comme les autres peuvent cohabiter. Tant que leur propre langue est parlée, francophones et anglophones sont toujours comme chez eux. Se comprendre ne fait que renforcer la cohésion des hommes pour l’expédition commerciale. L’Indienne, au contraire, est isolée à bord du Mandan. Aucun homme de son peuple ne l’accompagne. De princesse, la voilà réduite au statut de prisonnière. Sa nation ayant toujours été hostile aux marchands, elle est comme aux mains de l’ennemi. Et, pour l’équipage, la position paticulière qu’elle occupe en tant qu’otage ne fait que renforcer cette idée. Son refus est motivé par un code d’honneur implicite : si elle cherchait à parler ou à comprendre le français ou l’anglais, elle ne ferait que pactiser avec ses ravisseurs. La question de la langue est pour elle un enjeu moral. Elle la sépare concrètement de ses compagnons de voyage, instaurant une distance volontaire et presque insurmontable : comment se lier à quelqu’un qu’on ne peut absolument pas toucher, dont on ne peut obtenir une parole ? La langue représente ici la démarcation la plus tangible entre les peuples indiens et les « colons ». Le nom même par lequel la jeune femme est désignée, Teal Eye, lui a été donné par le vieux Zeb : s’ils foulent le même territoire, les Indiens et les pionniers restent cantonnés de part et d’autre d’une ligne infranchissable. Tout le problème est de savoir comment cette ligne apparaît.
Une scène inattendue viendra vite répondre à cette question. Alors qu’ils campent près du feu, l’équipage du bateau attend une attaque de la Compagnie, leur principal concurrent. Des hommes placés par le vieux Zeb montent la garde. Dans ce moment de pause, le thème principal du film semblent joués par les hommes de l’équipage, comme s’ils pouvaient pour la première fois prendre en main leur destin, ou du moins en prendre conscience. Aucun heurt sérieux n’ayant pour l’instant entravé le périple du Mandan, les hommes peuvent encore croire l’horizon grand ouvert, imaginer ce Big Sky sur lequel un panoramique ouvrait le film. Déjà, la mélodie était la même ; elle n’était que plus triomphante. Et puis, dans l’attente, un marin se met à jouer et un autre à chanter, remplaçant la composition de Dimitri Tiomkin par une vieille chanson française. Pour la première fois, Jim et Boone découvrent chez leurs compagnons une autre culture, une tradition qu’ils n’avaient pas soupçonnées. « Quand je rêve… » dit la chanson, « Quand je rêve…, j’ai mes lèvres sur tes lèvres »… Émus par ces instants de recueillement, les deux hommes demandent la traduction à leur voisin. « C’est une très vieille chanson » leur répond-il avant de leur en expliquer le sujet. Pour la première fois, les deux hommes ne sont plus seulement des nouveaux venus parmi ces hommes, ils sont de véritables étrangers. Ce qui n’apparaissait pas dans la conversation ou les échanges quotidiens se révèle dans le chant : la langue porte une culture qu’elle délimite, circonscrit pour Hawks, et à laquelle ces non francophones n’ont pas accès. Le montage juxtapose leur regard admiratif et celui du chanteur et des hommes d’équipage que cette chanson « retourne ». Un plan bref nous montre le capitaine ayant du mal à fermer l’œil. Le suivant nous dévoile un marin essuyant une larme. Celui d’après revient sur les deux héros, apparemment distraits et levant les yeux, seuls à remarquer que l’Indienne s’approche du feu. L’enchaînement des visages suffit à comprendre que les deux hommes restent un peu à l’écart de leurs compagnons, qu’ils ne peuvent se recueillir comme eux sur ces mots. Dans sa critique de La Captive aux yeux clairs, Eric Rohmer loue l’étrange précision de cet art. « Je ne connais pas de metteur en scène plus indifférent à la plastique, écrit-il à propos de Hawks, plus banal en son découpage, mais, en revanche, plus sensible au dessin exact du geste, à son exacte durée ». Au regard et à la voix, faudrait-il aussi rajouter. Car cette séquence va confronter par trois fois le jeu des regards inquiets à celui des paroles qui rassurent. Le calme du chant s’installant parmi les hommes, Teal Eye vient en effet saisir un flambeau devant ses deux prétendants et, le temps d’un gros plan, les toiser en soufflant sur sa torche. Un deuxième gros plan, d’à peine deux secondes, montre Boone la toisant à son tour et le regard de Jim passer de l’un à l’autre. La jeune fille s’éloignant, Jim en conclue que le danger est écarté : « J’ai cru qu’elle te le collerait dans la figure » avoue t-il et les deux hommes sourient. Un coup de fusil se fait aussitôt entendre, les hommes vont chercher leurs armes. Un homme dit avoir essayé de viser un indien. L’ensemble de la troupe recule et scrute la forêt. Rien n’est visible dans la nuit. Zeb, à haute voix, prononce quelques mots en indien. Une voix, invisible, lui répond depuis les branchages. Un Indien hilare apparaît et se met à parler devant les hommes méfiants. Jim, comprenant le mot « whysky », se met à rire, et Zeb donne la solution de l’énigme : c’est un Pied-Noir errant, un peu « dérangé ». Le groupe en éveil ne peut se rassurer, s’assembler en rond autour de l’objet présumé de la peur, ici, qu’après avoir nommé le danger dans sa langue. La langue démarque encore les peuples, leur proximité ne fait que révéler ces lignes de partage. L’Indienne vient voir son compatriote, prêt à étancher sa soif avec du whysky, et parle pour la première fois. Elle ne lui dit qu’une phrase, Zeb traduit : « un Pied-Noir ne doit pas boire l’alcool du blanc ». La langue, pour elle, ne sert ainsi qu’à prononcer les interdits culturels, à souligner l’écart entre son monde et celui des hommes qui l’entourent.
Les rapports entretenus avec la captive, mêmes muets, ne peuvent donc qu’être des rapports de rivalité. Un homme étant vite condamné au fouet pour avoir voulu toucher la jeune fille, tous s’en tiendront à une distance respectable. Tous, sauf les deux personnages principaux, aventuriers pour qui la séduction amoureuse n’est qu’un combat de plus en milieu hostile. Les rapports de domination inhérents à la position occupée par la prisonnière exacerbent naturellement les rapports amoureux, que Hawks, c’est un cliché, conçoit d’abord comme conflictuels. Le triangle amoureux le plus évident que le cinéaste ait mis en scène depuis Poings de fer, cœur d’or (1928) n’avoue là aussi ses tensions que par gestes et regards entrecoupés et rapides. Non pas que la langue soit inutile aux relations qui s’instaurent, mais elle sanctionnerait ici une histoire d’amour et une concurrence qu’aucun des trois personnages ne voudrait avouer. La parole est en quelque sorte le but à atteindre. Dans les péripéties qui les unissent, Jim, Boone, Teal Eye et Poor Devil, l’Indien simple d’esprit, ne s’entendront que par des gestes mutuels. En tant que traducteur, Zeb semble par conséquent disposer d’un véritable privilège. Ayant vécu avec les Pieds-Noirs, le vieil homme est le seul interlocuteur de la princesse tant convoitée. Il acquiert ainsi définitivement le statut de guide. C’est lui qui transmet, en niitsipussin, les informations nécessaires à la jeune indienne. Mais c’est aussi lui qui connaît le mieux la région et les différentes nations indiennes qui y vivent. Il est presque au dessus des antagonismes, il semble être de tous les peuples. L’exemple intrigue : annonce t-il une réconciliation possible ? Les langues pourraient-elles cohabiter dans un rapport idéal d’égalité ?
Les quelques jours passés dans la tribu des Pieds-Noirs éclairciront les rôles. Alors que dans le précédent western de Hawks, La Rivière Rouge (1948), l’apparition des Indiens ne se soldait que par une bataille rangée, le récit qui nous occupe différencie deux camps indiens, l’un étant l’allié de la Compagnie, l’autre celui des héros. Le premier, celui des Crows, se fera menaçant puis mènera l’équipage du Mandan à l’affrontement, mais il en va tout autrement du second, celui des Pieds-Noirs. Surgissant eux aussi brusquement sur les bords de la rive, ces derniers se révèlent être des amis et remorquent le Mandan. Le film s’installe alors pendant plus de quinze minutes au campement indien. Le commerce commence. Zeb fait le traducteur. Un plan d’ensemble nous présente la scène. A gauche, assis auprès de sa marchandise, Bourdonnais. Devant lui, à la droite du plan, Zeb est debout, prêt à parler à l’Indien qui se place entre eux pour marchander. Derrière les trois personnages, d’autres Indiens sont disposés en arc de cercle. Un panoramique, plus proche des personnages, vient préciser la forme de l’attroupement. Le trappeur et le capitaine sont bien encerclés, au centre de l’attention comme peuvent l’être les étrangers. Le vieux polyglotte n’est pas traité différemment de ses compatriotes. Il ne sert d’intermédiaire que d’un point de vue commercial. Il traduit ce que demande Bourdonnais par des phrases courtes, sans rien ajouter. Ces peaux « sont les moins chères que tu aies jamais achetées » glisse t-il à son ami, sans bien évidemment le traduire. Il détourne même un peu après les yeux de la scène, comme si son rôle était ailleurs.
La scène suivante le met autrement en scène. Un soir, alors que Teal Eye réapparaît et se présente à eux, Zeb est de nouveau devant ses compagnons. C’est lui qui rappelle les usages et, l’air passif, mène en réalité le jeu. Dans cette séquence de révélation, la princesse vient désigner celui qu’elle a choisi. Elle donne à Deakins un bijou symbole d’abondance et le vieil homme transmet le message : « …she says she loves you… », « …loves you like a brother » reprend-il. La jeune fille les remercie et fait alors un geste, en direction de Boone. Jim et le vieil homme se retournent vers ce dernier, lui faisant comprendre ce que l’on attend de lui sans le formuler : ils ne peuvent faire ce pas à sa place, leur rôle s’arrête là. Le jeune homme rejoint l’Indienne dans sa tente, les groupes sont définitivement dessinés. Zeb et Jim à sa suite mènent les hommes de l’équipage, mais restent parmi eux. Seul Boone peut passer outre l’écran de la traduction. Ne pouvant se faire comprendre de la jeune Pied-Noir, il lui donne son couteau : elle tranche le cordon qui laissait la tente entrouverte. La scène se passe entièrement de paroles ; l’un et l’autre doivent accepter de s’unir avant de parler la même langue. Il la regarde et elle hésite, puis jette le couteau à terre. Une danse s’enchaîne dans la nuit et Zeb en explique la cause à son neveu intrigué : son mariage avec la princesse est célébré. L’action s’est entièrement déroulée en deçà du langage. Le mariage fut « prononcé » sans un mot. Soucieuse de laisser Boone choisir, Teal Eye l’oblige cependant à « payer pour elle », pour qu’il soit libre. Dans la mythologie du pionnier que le film construit, le langage seul permet de conquérir véritablement le territoire idéal. L’aventurier devra donc se décider seul à rester et franchir, en toute connaissance de cause, la barrière de la langue. Incapable de cette dernière audace, il renonce, abandonne la jeune fille pour suivre ses camarades et s’embarque avec eux sur le chemin du retour.
A bord, le jeune homme s’isole et ne parle plus, comme s’il n’était plus chez lui et parlait déjà une autre langue. Peut-être s’est-il déjà décidé, mais il lui faut choisir librement son peuple – Zeb refusera d’ailleurs de lui dire les paroles, de lui raconter l’histoire qui l’aideraient à résoudre son dilemme. C’est la règle chez Hawks : les protagonistes doivent toujours éprouver seuls leur liberté avant de faire un choix, même celui du mariage. Le motif du scalp que transporte Boone, censé être celui de l’Indien qui a tué son frère, dessine une métaphore parfaite de l’idylle entre le jeune homme et Teal Eye. Symbole du racisme dont il fait preuve, ce scalp est ressenti comme un affront par l’Indienne : elle cherche à l’enterrer pour que l’âme de celui à qui il appartient puisse « aller en paix ». Les deux se l’arracheront violemment jusqu’à ce que, dans la dernière séquence du film, Boone décide de le jeter au feu avant d’avouer ses torts et de sceller, ainsi, son amour pour la princesse des Pieds-Noirs. Pour parler la langue, il faut passer de l’autre côté d’une ligne invisible entre les peuples, le jeune homme choisissant alors de repartir dans la tribu indienne. Il faut accepter de franchir une frontière qui ouvre sur un autre monde, et aucun langage commun n’est possible avant ce choix. Même le narrateur, s’il se révèle capable de communiquer avec les Indiens comme avec les Américains, n’a pas l’illusion d’appartenir aux deux peuples. Ayant quitté les Pieds-Noirs, il n’est plus là-bas chez lui mais ne peut non plus se résoudre à s’installer comme les autres trappeurs. Il ne peut quitter définitivement cette région qu’il connaît si bien. S’il l’on peut parler d’un culturalisme dans le cinéma de Hawks, c’est parce que ses héros, même libres, y doivent choisir en définitive leur univers. N’ayant su le faire à temps, le personnage de Zeb Calloway, mentalement apatride, est le symbole d’un échec. Il a choisi de rester voyageur, est condamné à le rester toujours. Les affaires faites, Français et Américains sont pressés de rentrer chez eux. Boone a choisi de rester parmi les Indiens et Jim de repartir, car « rien ne [le] retient ici ». Et Zeb ? Où va-t-on lorsque personne ne nous attend, lui demande Jim ? Le vieil homme répond par un haussement de sourcils…
Par sa nécessité, son étrangeté et parfois son absence, la langue devient l’horizon le plus difficile à atteindre pour les héros de La Captive aux yeux clairs. Elle représente la véritable frontière à laquelle se confrontent ces pionniers, celle qu’ils ne peuvent repousser indéfiniment. Si le français ne pose qu’un problème de références, c’est que le territoire qu’il découvre n’est que culturel, et se superpose ici à celui qu’habitent les américains anglophones. L’Indien recouvre au contraire un monde autre, clos, qui n’existe réellement que pour ceux qui font le choix d’y rester définitivement. Pour les autres, il reste un souvenir ou un mythe, le domaine privilégié du conteur qui, dès lors, ne peut plus être qu’un traducteur. Après s’être aventuré là « où personne n’est jamais allé », Hawks connaîtra l’espace de sa liberté. Il n’essaiera plus de plonger dans l’inconnu mais le gardera à portée de main, comme un jeu dangereux. Tel les héros du safari d’Hatari ! , ou les pilotes de Ligne Rouge 7000, Howard pourra rester au chaud, chez lui, mais jamais loin de la piste où tout se joue.
M.P



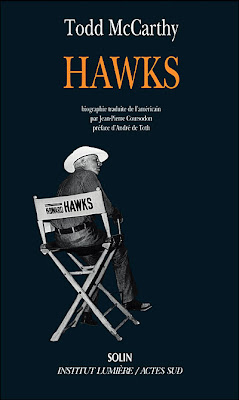






.jpeg)










