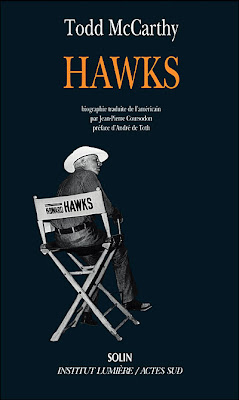Howard Hawks, héritier gâté d’une riche famille du Wisconsin. Howard Hawks, étudiant médiocre s’encanaillant dans les bars de New York. Howard Hawks, jeune pilote mystérieux risquant sa vie dans des courses sauvages, sur les routes poussiéreuses de la Californie. Howard Hawks, playboy à
La biographie qu’il dresse est, pour tout dire, à la fois admirable et vaine, formidable parce que vouée à l’échec. Si vous vouliez entrer dans l’intimité du grand homme, passez votre chemin : cette somme ne vous sera d’aucune utilité. Ce travail là est sérieux : pas question pour son auteur de mettre en scène le quotidien d’H. H. Il s’agit simplement de raconter, épisode après épisode, ce que l’on sait de la vie de Hawks, preuves à l’appui et toute anecdote vérifiée. McCarthy rapporte évènement après évènement : décès, mariages, succès et échecs. Il retrouve le nom des collaborateurs de chaque film, infirme beaucoup des histoires du vieux motard, rétablit les faits. Œuvre d’historien, effort de documentation dont les américains sont seuls capables. Outil précieux qui apporte des pièces aux dossiers : Hawks aurait bien diriger La Chose d’un autre monde, n’aurait effectivement rien fait sur Autant en emporte le Vent, etc., etc.… Tout est affaire de faits. Tout, et même un peu n’importe quoi.
À l’américaine, le critique croit toucher au génie d’Howard en énonçant les « qualités » de ses films : un bon scénario bien « personnel », de bons dialogues bien vifs, de bons acteurs bien en forme, de bons décors bien utilisés + (pour les chefs-d'œuvres) un bon rythme bien rapide, de bonnes idées plastiques (qui n’ont pas trop vieillies) et, bien sûr, une bonne mise en scène bien bonne. À l’américaine, aussi, il s’imagine expliquer la fascination qu’a inspirée le personnage à partir de son comportement. Conscient de la portée réelle de son pavé, il ne prétend d’ailleurs pas « comprendre » H.H. . Il ne veut qu’approcher l’homme en se limitant à l’indiscutable, l’incontestable.
Sa thèse est amusante : Hawks, naturellement doué pour la mise en scène, s’aguerrissant dans les années 30, aurait connu un « âge d’or », de Seuls les anges ont des ailes à La Rivière Rouge comprise, soit huit films, puis une perte de contrôle progressive et difficile de ses réalisations. Moment privilégié fait de succès publics ininterrompus, de réussites artistiques indéniables, de personnages masculins trouvant enfin un équilibre avec les femmes, qui correspond, exactement, aux huit ans de sa liaison avec Nancy Raye Gross, « Slim », sa deuxième femme. Les films précédents passent donc presque pour des ébauches : l’inoubliable Poings de fer, cœur d’or (1928) n’est considéré qu’au regard de ce qu’il annonce, plus ou moins, du style hawksien, l’extraordinaire Après nous le déluge (1933) n’est respecté que pour ses scènes d’action et le merveilleux Viva Villa ! (1934), entre autres, est exécuté en une phrase justifiée par une citation – cette fois approuvée – du cinéaste lui-même. Comme lui, le biographe suit en fait essentiellement le nombre d’entrées pour juger de la réussite d’un film. Il n’est qu’un peu plus difficile et définitif que les spectateurs d’époque avec La Captive aux yeux clairs (« le drame est rarement captivant »), Monkey Business (« l’action est dans l’ensemble mécanique et laborieuse, comme conduite machinalement selon un plan préexistant » !), ou même Les Hommes préfèrent les blondes et les films qui suivent. « Pour paraphraser Jacques Rivette : la médiocrité de Ligne Rouge 7000 s’impose à l’esprit par l’évidence » : sûr de lui, le scélérat ose même parler de « fiasco » !
Inutile d’énumérer tous ces jugements à l’emporte-pièce ; leur auteur en est fier : s’il peut critiquer Hawks, c’est, évidemment, qu’il a du recul... Cette critique «objective » qui marche aux « qualités » est d'ailleurs plus amusante qu’autre chose : pour le biographe comme pour Hawks, il s'agit simplement de savoir qui a eu ou aura la plus grosse dans la vie, donc le studio, donc le film – pensée claire, cohérente, admirable ! Ceux qui continuent à fonctionner un peu partout ainsi parlent de thèmes, de style, et sont alors prêts à s’attaquer à tout. L’ouvrage de Todd McCarthy, ses limites évidentes, est de ce point de vue exemplaire : on établirait l’emploi du temps d’Howard que rien n’y ferait, Hawks reste le plus mystérieux des cinéastes. Pas une photo d’époque, un photogramme oublié qui ne semble émerger d’un monde indifférent aux tourments que vient de nous raconter le biographe ; pas une déclaration qui n’échappe aux bémols que leur appose le chercheur.
Au fond, l’utilité de l’outil biographique n’est pas ici d’expliquer le génie de l’homme mais de montrer qu’il est inexplicable. C’est malgré les évènements, les drames –il en y a quantité-, contre eux, venant d’où ne sait où et voyant bien trop loin que l’art se déploie. Hawks, d’ailleurs, est le cinéaste de la liberté : on ne le comprend pas, on le salue. On n’entrevoit la portée de sa vision qu’en acceptant qu’elle nous entraîne et nous dépasse à la fois. Au fond, H.H. est une Boule de feu : sa vie n’a d’intérêt que si on la confronte à celle qu’il s’inventait. À l’américaine, il voyait le burlesque et le tragique en toute chose. À l’américaine, le quotidien était déjà sa poésie, le n’importe quoi était déjà chez lui du sublime.
« Un jour, chez moi », raconte t-il, « une fille, très belle, est devenue aveugle en buvant de l’alcool de contrebande. Pendant que nous attendions le docteur elle a dit : « Je suis peut-être aveugle mais ça ne veut pas dire que je ne me débrouille pas bien au lit. » » Hawks dit qu’il « aimait cette attitude ».
M.P